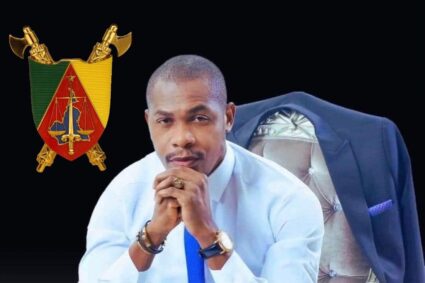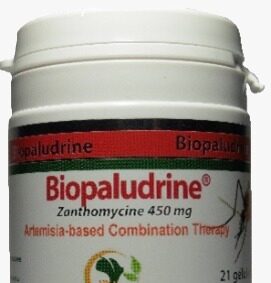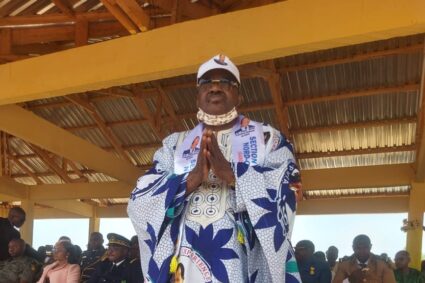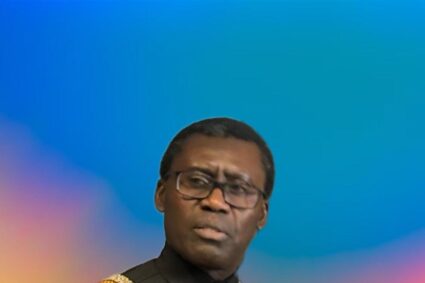Spécialiste de Sciences politiques, promoteur de médias et membre actif de la société civile, il donne le point de vue du Mouvement Les Bâtisseurs sur le déroulement de la crise anglophone. Pour résoudre cette crise dont les victimes se comptent désormais par millions, les Bâtisseurs en tant que mouvement de la société civile entendent continuer à jouer leur rôle de médiateurs et de promoteurs de la paix, pour la promotion d’ un Cameroun stable, uni et respectueux des droits de tous ses citoyens.
Depuis 2016, la crise dite anglophone secoue principalement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après près de 9 ans, quel bilan pouvez-vous faire sur les dégâts causés par cette crise, sur les plans humain, économique, et sur le vivre-ensemble entre Camerounais ?
Le bilan de cette crise est catastrophique à tous les niveaux. Sur le plan humain, des milliers de personnes ont été tuées, parmi lesquelles de nombreux civils innocents. Des villages entiers ont été brûlés, des familles déplacées, et une génération entière d’enfants a été privée d’éducation en raison des écoles fermées ou détruites.
Économiquement, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, autrefois dynamiques dans les secteurs agricole et commercial, sont en ruine. Les entreprises ont fermé, les investisseurs ont fui, et la population survit dans des conditions précaires.
Sur le plan du vivre-ensemble, le tissu social est profondément déchiré. La méfiance entre les communautés a augmenté, et le sentiment d’exclusion des populations anglophones vis-à-vis du gouvernement central s’est exacerbé. Cette crise a renforcé les clivages au sein de la nation et a alimenté un cycle de violence qui semble sans fin.
Pensez-vous que l’État veut vraiment mettre fin à cette crise ?
D’après mon expérience et mes échanges avec différentes parties, il est difficile de dire que le gouvernement du Cameroun a une réelle volonté de résoudre la crise de manière pacifique. Dès 2016, nous avons appelé au dialogue et à une résolution politique du conflit afin d’éviter l’escalade. Malheureusement, ces appels ont été ignorés.
Récemment encore, un interlocuteur proche du gouvernement m’a confié que l’approche actuelle repose sur une solution militaire, avec la conviction que l’État peut simplement éliminer tous les combattants séparatistes. Cette stratégie est non seulement irréaliste mais aussi dangereuse, car elle continue d’exposer des civils innocents à la violence et ne répond pas aux causes profondes du problème.
Si la volonté politique existait réellement, des mesures concrètes auraient été prises pour un dialogue inclusif et sincère. Mais jusqu’à présent, les efforts vont dans le sens de la répression plutôt que de la réconciliation.
Plusieurs Camerounais vivant à l’étranger continuent d’envoyer de l’argent pour financer la guerre et d’autres appellent au meurtre de leurs compatriotes Camerounais en toute impunité. Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer cette impunité ?
L’impunité est due à plusieurs facteurs.
Premièrement, il y a un manque de coopération internationale efficace dans la lutte contre le financement du terrorisme et des crimes de guerre. Contrairement à d’autres pays comme la Norvège ou la Finlande, qui ont pris des mesures contre certains leaders séparatistes vivant à l’étranger, les gouvernements britannique et américain n’ont pas encore agi contre ceux qui, depuis leurs territoires, incitent à la violence au Cameroun.
Deuxièmement, certains pays occidentaux voient cette crise comme un conflit interne camerounais et hésitent à intervenir de manière proactive. Cela permet aux instigateurs basés à l’étranger de continuer leurs activités sans être inquiétés.
Enfin, les divisions au sein même des institutions camerounaises ont empêché une réponse cohérente et efficace à ce phénomène. L’absence de poursuites contre ceux qui alimentent le conflit, qu’ils soient du côté séparatiste ou du gouvernement, crée un climat où la violence est encouragée et entretenue.
D’après vous, que faut-il faire pour mettre définitivement un terme à cette guerre ?
La seule solution durable est un dialogue inclusif, sincère et impartial.
Reconnaître la dimension politique du conflit : La crise anglophone ne peut pas être réduite à une simple question de terrorisme ou de banditisme. Il s’agit d’un problème politique enraciné dans des décennies de marginalisation et d’injustices ressenties par la population anglophone.
Organiser des négociations sous médiation internationale : Des acteurs neutres comme l’ONU, l’Union africaine ou d’autres pays crédibles doivent être impliqués pour garantir un dialogue équitable et transparent.
Mettre fin à l’impunité : Tous ceux qui ont commis des crimes – qu’ils soient du côté séparatiste ou du gouvernement – doivent être traduits en justice. Tant que l’impunité perdure, la violence continuera.
Créer un cadre de gouvernance décentralisée : Une réforme institutionnelle est nécessaire pour répondre aux aspirations des populations locales et garantir une meilleure inclusion des anglophones dans la gestion du pays.
Éduquer et sensibiliser : Il faut mener des campagnes de sensibilisation pour réconcilier les communautés et combattre la propagande qui alimente la haine et la division.Quels sont les principaux obstacles à un retour à la paix ?
Les principaux obstacles sont :
L’absence de volonté politique réelle du gouvernement.
La radicalisation de certains groupes séparatistes.
L'implication d’acteurs étrangers qui financent et encouragent la violence.
Le manque de confiance entre les différentes parties.Quel rôle la diaspora camerounaise pourrait-elle jouer pour la paix ?
Plutôt que de financer la guerre, la diaspora pourrait :
Faire pression sur les gouvernements des pays d’accueil pour sanctionner ceux qui encouragent la violence.
Investir dans la reconstruction des régions touchées.
Soutenir les initiatives de dialogue et de médiation.Quel message souhaitez-vous adresser aux populations prises entre deux feux ?
Je leur dirais que je comprends leur souffrance et leur douleur. Je suis moi-même une victime de cette crise avec la perte tragique de mon frère. Mais je veux aussi leur dire qu’il ne faut pas perdre espoir. Nous devons continuer à nous battre pacifiquement pour une solution juste et durable. La guerre n’apportera jamais la paix. Seule la justice et le dialogue pourront nous permettre de reconstruire un Cameroun uni et stable.
Quel rôle les Bâtisseurs de la Nation peuvent-ils jouer dans la résolution de cette crise, étant donné que vous êtes l’un des membres fondateurs ?
Les Bâtisseurs de la Nation ont un rôle essentiel à jouer dans la recherche de solutions durables à cette crise. En tant que plateforme citoyenne, nous avons toujours œuvré pour une approche inclusive, basée sur le dialogue et la réconciliation.
Notre action peut se concentrer sur plusieurs axes :
Plaidoyer pour une résolution pacifique : En tant que voix influente de la société civile, nous pouvons faire pression sur les décideurs politiques et la communauté internationale pour qu’une solution juste et durable soit mise en place.
Sensibilisation et éducation : Nous devons œuvrer pour déconstruire la propagande extrémiste et promouvoir un discours de paix, en montrant que la guerre ne peut pas être une solution.
Encourager la réconciliation nationale : En facilitant des rencontres et des échanges entre les différentes communautés affectées par le conflit, nous pouvons aider à recréer la confiance et restaurer le tissu social.
Accompagner les victimes : À travers des projets de reconstruction et de soutien aux populations déplacées ou traumatisées, nous pouvons contribuer à réparer les dégâts causés par la guerre et offrir des perspectives d’avenir aux populations affectées.Les Bâtisseurs de la Nation doivent continuer à jouer leur rôle de médiateurs et de promoteurs de la paix, en restant fidèles à notre engagement initial : œuvrer pour un Cameroun stable, uni et respectueux des droits de tous ses citoyens.
Interview menée par Adèle Amaléga