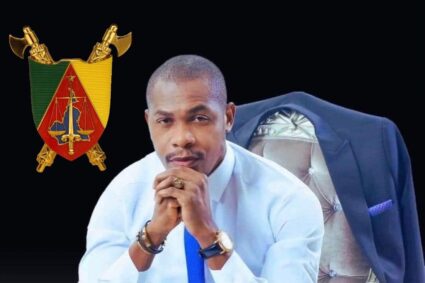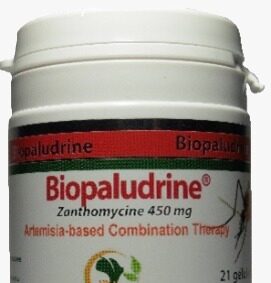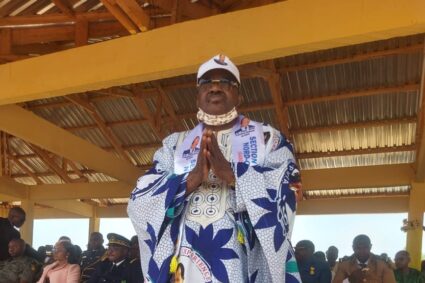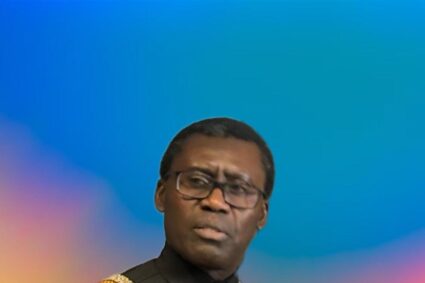Le Sommet Nutrition for Growth (N4G) de Paris s’est achevé vendredi sur une note ambitieuse : plus de 27 milliards de dollars ont été mobilisés pour lutter contre l’insécurité alimentaire, un défi indissociable des enjeux climatiques et de paix. Si cet engagement international est crucial, son succès dépendra de son ancrage local. Au Cameroun, où près de 30 % de la population souffre de malnutrition chronique selon la FAO, la société civile, soutenue par des initiatives comme le Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI) Transition Écologique, incarne cette transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables.
Cameroun : un écosystème agricole sous tension
Avec une économie encore largement dépendante de l’agriculture (elle emploie 60 % de la population active), le Cameroun fait face à une double crise : les dérèglements climatiques (sécheresses, inondations) et les conflits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui ont déplacé plus de 700 000 personnes et perturbé les circuits de production. Résultat : malgré un potentiel agronome immense (sols fertiles, diversité climatique), le pays importe massivement des denrées de base, tandis que les petits producteurs peinent à vivre de leur travail.
La société civile camerounaise en première ligne
Face à ce paradoxe, des organisations locales se mobilisent pour promouvoir une alimentation saine, accessible et respectueuse de l’environnement. Par exemple, l’association RELUFA (Réseau de Lutte contre la Faim) promeut l’agroécologie via des formations aux techniques sans pesticides, tandis que des coopératives féminines, comme dans la région de l’Adamaoua, développent des circuits courts pour valoriser les produits locaux (igname, soja, miel). Ces acteurs défendent aussi une souveraineté alimentaire face à l’invasion des produits ultra-transformés, responsables de maladies chroniques en hausse.
Le FSPI Transition Écologique : un levier pour l’autonomie des producteurs
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’appui du FSPI Transition Écologique, financé par la France. Ce dispositif accompagne les projets camerounais alliant performance économique et préservation des écosystèmes. Parmi les initiatives soutenues : l’installation de systèmes d’irrigation solaire pour les maraîchers périurbains, la certification bio de filières cacao, ou encore la modernisation de l’élevage pastoral avec des techniques réduisant la déforestation. L’objectif est clair : rendre l’activité agricole plus rentable pour les 4 millions de petits exploitants, tout en captant le carbone et en protégeant la biodiversité.
Des défis persistants, des raisons d’espérer
Si les avancées sont réelles, les obstacles restent immenses. L’accès au crédit, le manque d’infrastructures rurales et la concurrence des importations subventionnées freinent la transition. Pourtant, des solutions émergent : les banques communautaires facilitent le microcrédit agricole, et des partenariats public-privé se développent pour équiper les zones reculées. Par ailleurs, la jeunesse camerounaise, connectée et innovante, investit l’agritech, avec des applications optimisant la gestion des récoltes ou la commercialisation.
Une dynamique à amplifier
Le Sommet N4G rappelle que la sécurité alimentaire est un pilier de la stabilité mondiale. Au Cameroun, l’alliance entre société civile, bailleurs internationaux et États pourrait servir de modèle : en misant sur l’écologie et l’équité, elle prouve que nourrir la planète ne nécessite pas de choisir entre rentabilité et durabilité. Les 27 milliards de dollars engagés à Paris devront prioriser ces initiatives locales, seules capables d’impulser une transformation pérenne. Car, comme le résume une agricultrice de Bafoussam : « Semons des solutions aujourd’hui pour récolter la paix de demain. »
Emmanuel Ekouli